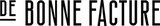PORTÉ PAR
Hedi Sersoub & Zeid Habayeb
Matière à Réflexion
Photographié by Eoghan Gilmore
Interview par Déborah Sitbon Neuberg
Bonjour Hedi, bonjour Zeid !
En préparant cet éditorial, je me suis rendu compte que nous nous étions tous rencontrés grâce à la collaboration entre De Bonne Facture et le magazine Monocle, puisque Zeid y était responsable retail et e-commerce à l’époque. Quant à toi, Hedi, tu es un visage familier des pages éditoriales mode.
Zeid, je n’oublierai jamais la lettre que tu m’as écrite lorsque tu as quitté Monocle pour te lancer dans une nouvelle aventure en tant que chef. Elle m’a profondément touchée, notamment lorsque tu m’as raconté l’histoire de ta famille et la romance entre ton arrière-grand-mère juive et ton arrière-grand-père chrétien à Jérusalem. Les mots que tu as choisis pour exprimer ce que tu ressentais en regardant nos photographies chez De Bonne Facture m’ont apporté un soutien empreint de tendresse. Je me suis sentie reconnue dans ma quête d’une représentation plus nuancée dans le paysage occidental du prêt-à-porter masculin.
Hedi, notre rencontre s’est faite par hasard lors de l’ouverture du café Monocle à Paris, quand je suis tombée sur ton frère Waël qui avait posé pour l’une de nos Éditions… il y a dix ans déjà ! Nous avons eu une conversation passionnante sur ton héritage franco-algérien et la diversité des origines ethniques en Afrique du Nord. Il se trouve que Zeid avait présenté De Bonne Facture lors de son dernier shooting pour Monocle auquel tu avais participé, et je suis ravie d’apprendre que tu as toujours été fan de la marque. Je suis très heureuse d’avoir cette conversation avec vous.
Vous identifiez-vous tous les deux comme des hommes arabes ? Dans quels contextes vous identifiez-vous davantage par votre nationalité, votre origine ethnique — mixte, kabyle, interreligieuse ou autre ?
H : Je m’identifie avant tout comme un être vivant, connecté à tout ce qui m’entoure : la vie, la nature. Ayant grandi en France dans une famille mixte arabe et française, je suis attaché à mon héritage arabe, mais je ne me définis pas strictement comme Français ou Algérien ; je me considère plutôt comme un mélange d’influences diverses, façonné par mes expériences de vie. J’ai l’impression que mes parents sont plus ancrés dans leurs origines — mon père étant kabyle et ma mère française. Quant à moi, je suis un mélange, mais ce sont surtout mes expériences qui ont fait de moi ce que je suis. J’ai grandi dans la religion musulmane, à laquelle je ressens un profond attachement, mais je ne me considère plus du tout comme religieux aujourd’hui.
Z : Je m’identifie clairement comme un homme arabe, et plus précisément, je suis très fier de m’identifier comme un homme palestinien. Même si je suis né et ai grandi en Jordanie, je viens d’une famille palestinienne fière de ses racines, qui a toujours célébré et honoré son héritage. En ce qui concerne la religion, je ne dirais pas que je suis chrétien pratiquant aujourd’hui, mais il est important pour moi de m’identifier comme chrétien palestinien, car c’est un groupe souvent mis de côté dans le contexte de la situation en Palestine. Beaucoup de mes souvenirs d’enfance les plus précieux sont liés aux fêtes religieuses (Noël, Pâques, etc.) — c’étaient des moments où toute la famille se réunissait et où mes plats préférés étaient servis. J’apprécie donc ces éléments religieux surtout d’un point de vue culturel et social.
Votre expérience en tant que personne d’origine moyen-orientale ou nord-africaine a-t-elle été différente en Europe par rapport à d’autres continents ? À Paris plutôt que dans d’autres villes européennes ?
H : Je n’ai pas remarqué de différences majeures entre l’Europe et d’autres continents, mais le passage de Paris à Londres a été assez marquant pour moi. Paris ne m’a jamais vraiment semblé être chez moi, surtout que je venais de Lyon, et j’ai eu du mal à y trouver ma place. En revanche, à Londres, je me suis senti chez moi presque immédiatement. En seulement trois mois, j’ai perçu une ambiance différente — un endroit où des communautés très diverses cohabitent sans jugement, et cela m’a fait énormément de bien.
Z : Je me sens également très chez moi à Londres. Je trouve que la ville est un bel exemple d’intégration réussie, et je ne m’y suis jamais senti étranger. En comparaison avec l’Amérique du Nord, où j’ai passé la majeure partie de ma vingtaine, j’ai trouvé que là-bas, les gens avaient tendance à vous considérer comme “autre” plus rapidement, en demandant par exemple : « mais tu viens d’où, vraiment ? » — pas forcément de manière malveillante, mais cela traduit tout de même une forme de distance. À Londres, j’ai le sentiment que l’on part du principe que vous êtes londonien, peu importe votre apparence ou votre accent, et cela change tout.
Comment la masculinité arabe s’exprime-t-elle dans votre vie ? Ressentez-vous quelque chose de particulier dans cette intersectionnalité ? Est-ce quelque chose que vous exprimez à travers votre style, vos vêtements, ou autrement — par exemple une certaine politesse, un comportement ?
H : Nous sommes une famille d’hommes, avec beaucoup de cousins et d’oncles, et étant l’un de trois frères, j’ai toujours ressenti un lien très fort avec les hommes de ma famille. À l’adolescence, j’exprimais parfois mes origines à travers mon style, en portant un keffieh au lycée, ce qui était peut-être une manière d’affirmer mes racines. J’ai l’impression que les hommes arabes sont souvent perçus comme forts, avec un sens de l’honneur et une certaine retenue émotionnelle. Mais pour moi, l’aspect le plus important, c’est le lien à la famille. Et je pense qu’en réalité — ou du moins dans ma famille — ils sont émotionnels ; ils montrent beaucoup d’amour à leurs proches. Mon père m’a très tôt fait comprendre que rien ne serait jamais plus important que le lien avec mes frères. Mon grand frère est d’ailleurs très similaire : sa générosité envers nous ressemble presque à celle d’un père, et je trouve cela très beau.
Z : En ce qui me concerne, je viens d’une famille de femmes très fortes, ce sont elles qui tenaient vraiment les rênes à la maison. Je ne suis pas sûr qu’il y ait une manière consciente dont j’exprime ma masculinité arabe au quotidien. Je pense qu’elle transparaît dans certains comportements qui sont communs à la culture arabe en général, pas uniquement masculins : honorer et respecter les aînés, faire preuve de gentillesse et de générosité envers les invités, cuisiner et servir les gens qui entrent chez nous, maintenir une grande propreté — personnelle et générale —, faire preuve de tendresse et d’un contact physique affectueux. Je trouve d’ailleurs intéressant que ces comportements, qui sont très valorisés chez nous, soient souvent considérés en Occident comme "peu virils". C’est une belle inversion des codes, et elle me semble très révélatrice.

Comment êtes-vous passé du statut de garçon à celui d’homme en tant qu’Arabe ? Cela s’est-il accompagné d’un rituel ou d’un moment particulier dans votre vie ?
H : Pour moi, le passage de garçon à homme a été davantage une question de développement personnel que d’identité arabe à proprement parler. Un moment marquant a été à 14 ans, quand j’ai décidé de faire le Ramadan en entier pour la première fois. Jusque-là, mes parents me laissaient le faire partiellement, seulement le week-end par exemple. Mais cette année-là, j’ai senti que j’étais prêt à m’engager pleinement — et je l’ai fait. Réussir à tenir tout le mois a été une vraie fierté : j’ai prouvé à moi-même que j’étais capable de discipline et de volonté.
Z : Je ne pense pas qu’il y ait eu un seul moment ou un rituel précis qui ait marqué cette transition. C’était plutôt une accumulation de moments marquants dans ma vie, à la fois sur le moment et avec le recul. La première fois que j’ai quitté la maison pour aller vivre seul aux États-Unis, le jour où j’ai quitté le monde de l’entreprise pour devenir chef, ou encore le décès de mon père. Ce sont tous des événements qui ont constitué des tournants, des moments où j’ai ressenti une séparation claire entre un "avant" et un "après".
Shirvan par Akrame Benallal
5 Pl. de l'Alma, 75008 Paris
Y a-t-il des idées reçues avec lesquelles vous devez souvent composer, et sur lesquelles vous vous sentez obligé d’éduquer les gens autour de vous ?
H : Ayant grandi dans la religion musulmane mais n’étant plus pratiquant aujourd’hui, je me retrouve souvent à devoir clarifier certaines idées reçues. Beaucoup de gens supposent automatiquement qu’être arabe signifie être musulman, et inversement. Mes choix alimentaires, par exemple, prêtent souvent à confusion : je ne mange pas de porc, mais je bois de l’alcool. Ces subtilités sont parfois difficiles à faire comprendre, car beaucoup s’appuient sur des stéréotypes dépassés.
Z : De mon côté, on me demande presque chaque semaine si je mange du porc — sans doute parce que je travaille en cuisine et que je suis constamment entouré de nourriture. Je ne suis pas offensé par la question en soi, mais elle reflète bien cette idée fausse selon laquelle « arabe » signifie nécessairement « musulman », ce qui contribue à l’effacement des chrétiens dans l’identité arabe. Ce que je trouve encore fou, quand on pense que Jésus était un homme palestinien. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres : chaque fois que je dis que je suis palestinien, les gens se sentent autorisés à partager avec moi toutes leurs opinions — souvent mal informées — sur la question, et je me retrouve à devoir leur expliquer des bases qu’ils pourraient très bien apprendre par eux-mêmes.
Que pensez-vous de la scène culinaire arabe dans la ville où vous vivez ? Et qu’est-ce qui définit pour vous la cuisine arabe ?
H : À Lyon, je dirais que la scène culinaire arabe est correcte, mais je n’en profite pas tant que ça à l’extérieur. La plupart du temps, je mange de la cuisine arabe chez moi, en famille. Ce sont des repas qui ont toujours une dimension à la fois festive et intime, partagés à la maison avec nos proches. À Londres, j’ai trouvé qu’il était très facile de manger arabe. Même à Paris, il y a d’excellents restaurants, comme celui de mon ami Akrame, Shirvan, place de l’Alma, un lieu inspiré par la Route de la Soie.
Z : Pour moi, Londres est sans conteste l’une des meilleures villes au monde en matière de diversité culinaire. Mais je ne dirais pas que la cuisine palestinienne y est particulièrement présente ou bien représentée. On peut trouver de la très bonne cuisine libanaise, et des restaurants turcs incroyables, mais j’aimerais voir la cuisine palestinienne aller au-delà du traditionnel sandwich shawarma ou falafel. Cela dit, je suis heureux de voir que les choses évoluent lentement. Des ouvertures comme Akub, le restaurant du chef palestinien Fadi Kattan à Notting Hill, permettent aux gens de découvrir une palette de plats, d’ingrédients et de saveurs palestiniennes plus variés et authentiques.


Y a-t-il des plats préférés qui vous rappellent votre enfance ou des traditions familiales ?
H : Le couscous de ma mère, la chorba que l’on mangeait pendant le Ramadan, et le felfel algérien sont des plats qui me rappellent mon enfance et font sûrement partie de mes plats préférés. Ma mère, bien qu’elle soit française, est une cuisinière exceptionnelle, et tous ceux qui ont goûté son couscous s’accordent à dire qu’il est délicieux.
Z : La maqlubeh est mon plat préféré de tous les temps — à chaque fois que je sens des aubergines en train de frire, je suis immédiatement transporté chez moi. Lors des grandes occasions, on préparait toujours du waraq dawali (feuilles de vigne farcies), un plat très long à réaliser, avec toutes les femmes de la famille réunies autour de la table pour en rouler des centaines. C’est un bel exemple de la manière dont les Arabes expriment leur amour à travers la nourriture.
Quels sont les goûts et les odeurs qui vous donnent cette sensation de “chez vous” ?
H : Les odeurs de chorba et de gâteaux aux amandes me rendent toujours heureux. Rien que le fait de rentrer à la maison et de sentir ces parfums, c’est tout de suite réconfortant.
Z : Une autre odeur que j’adore, c’est celle des oignons caramélisés avec du sumac, car elle annonce le musakhan, le plat national palestinien. Je pourrais en parler pendant des heures — c’est peut-être subjectif, mais je pense sincèrement que notre cuisine est la meilleure.
Que diriez-vous à votre “vous” plus jeune à propos de votre identité ?
H : Je lui dirais d’explorer plus en profondeur nos origines familiales, d’apprendre la langue, et de s’intéresser aux histoires de nos ancêtres, surtout celles de mon grand-père. Comprendre notre héritage m’aurait permis de nourrir un sentiment d’identité plus riche et plus ancré.
Z : J’ai toujours été très fier de ma culture et de mes origines. Mais je pense qu’à l’adolescence, j’avais tendance à considérer la culture occidentale (musique, télé, cinéma, culture pop en général) comme supérieure aux autres. J’aurais aimé m’ouvrir plus tôt à la nôtre. Il y a une richesse incroyable dans l’histoire musicale et cinématographique du Moyen-Orient — de l’Égypte au Liban, en passant par la Palestine et les pays du Golfe.
Y a-t-il des poètes, chanteurs, écrivains ou musiciens que vous aimeriez partager avec nos lecteurs ?
H : Idir, chanteur kabyle, est un artiste que j’admire beaucoup. C’est le premier que j’ai vu en concert quand j’étais jeune, et sa musique représente magnifiquement la culture kabyle. Je suis fier d’avoir cet héritage. J’aime aussi Jalâl ad-Dîn Rûmî, qui a beaucoup écrit en persan, ainsi que Khalil Gibran, qui aborde des thèmes comme la spiritualité, l’amour et la condition humaine. Et je pense aussi à Dalida, qui a marqué la culture française tout en étant d’origine égyptienne — ma mère l’écoutait beaucoup à la maison.
Z : Si vous ne connaissez pas Fairouz, je commencerais par là. C’est probablement l’une des plus grandes voix de l’histoire du monde arabe. Sa voix et ses chansons sont immédiatement reconnaissables pour la majorité des Arabes. J’écoute aussi beaucoup Majida El Roumi, une chanteuse libanaise dont le répertoire va des classiques arabes aux chants folkloriques, en passant par les hymnes religieux et patriotiques. Warda était la chanteuse préférée de mes parents, et je l’écoute très souvent. J’ai même eu la chance de trouver un vinyle de l’un de ses albums pendant ce voyage à Paris (petite dédicace à Modular Records et au label français indépendant Wewantsounds, qui remastérise et réédite de rares classiques).
J’adore cette référence. La musique de Warda a également accompagné mon enfance. J’adore lire les traductions de ses chansons d’amour.
Z : Côté littérature, je recommande vivement les livres de Ghassan Kanafani, en particulier Des hommes dans le soleil. Et je mettrais aussi en avant son pendant féminin, Ghada Al-Samman, qui a une maîtrise incroyable de la langue arabe classique. Son roman Beyrouth 75 est un chef-d’œuvre.
Que vous évoque la Route de la Soie ?
H : Elle me fait penser à ces grandes routes commerciales qui reliaient l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe occidentale. C’était une époque d’échanges culturels intenses, où des marchandises, des idées et des savoirs circulaient sur de très longues distances — une belle illustration de l’interconnexion des civilisations dans l’histoire humaine.
Z : Pour moi aussi, elle symbolise cette interconnexion profonde entre les peuples. Nous avons, en tant qu’êtres humains, bien plus de points communs que de différences. Et si nous choisissions de célébrer davantage ce que nous partageons plutôt que ce qui nous sépare, nous nous en porterions tous mieux. Nos histoires sont interconnectées — et notre avenir l’est tout autant. Les défis que nous affrontons, qu’il s’agisse des guerres, du changement climatique ou de l’insécurité alimentaire, sont des problèmes que nous ne pouvons résoudre qu’ensemble.
Dernière question : dans la tradition juive, les noms ont une grande importance et sont censés influencer profondément la vie de ceux qui les portent. Quelle est la signification de vos prénoms et noms de famille ?
H : Hedi est un prénom d’origine arabe, enraciné dans la tradition islamique. Il évoque quelqu’un qui guide les autres avec sagesse, patience et clarté. Mon autre prénom, Amokran, était celui de mon grand-père. C’est un prénom masculin d’origine berbère profonde. Il symbolise le courage, le leadership, la noblesse et l’ancrage culturel. Dans de nombreuses communautés amazighes, porter ce prénom est un signe de respect, d’héritage et de force morale. Mon nom de famille, Sersoub, reflète un héritage algérien, possiblement berbère aussi. Qu’il soit lié à une plante, un oiseau ou à un compagnon tribal, il évoque la nature, le voyage et l’identité.
Z : Zeid vient de l’arabe et signifie “croissance” ou “abondance”. Quant à mon nom de famille, Habayeb, il signifie “les amoureux”. C’est le même mot que habibi (mon amour), mais au pluriel. Cela ne désigne pas forcément des amoureux au sens romantique ; il peut s’agir de deux — ou plusieurs — personnes très proches et unies par un lien d’amour profond. On peut appeler habayeb des gens qui s’aiment sincèrement, de façon intime et affectueuse, quel que soit le contexte.
C’est magnifique, merci à vous deux !
Merci à Akrame Benallal et l'équipe de Shirvan, Bernadette à Le Sedaine Bar et l'équipe de la Grande Mosquée de Paris.